En France, l’agrivoltaïsme suscite autant d’espoirs que d’interrogations. Cette technologie, qui marie panneaux solaires et production agricole, transforme notre rapport à l’énergie et à l’agriculture. Les premiers résultats sont encourageants : protection des cultures contre les aléas climatiques, production d’électricité verte, diversification des revenus agricoles. Pourtant, le déploiement reste timide. Entre un cadre réglementaire instable, des agriculteurs parfois méfiants et des défis techniques persistants, les obstacles se multiplient. Analyser les freins à l’agrivoltaïsme permet d’identifier des solutions concrètes pour accélérer cette transition nécessaire.
La réglementation agrivoltaïsme : un frein majeur
Le cadre législatif français pose paradoxalement l’un des premiers obstacles au développement de l’agrivoltaïsme. La loi APER de 2023 a certes posé les bases d’un encadrement, mais plusieurs zones d’ombre persistent et freinent les investissements.
Le décret du 8 avril 2024 ajoute également sa part de complexité. Censé clarifier les conditions de développement, il introduit de nouvelles contraintes. La limitation à 40 % de couverture des sols et les exigences renforcées de suivi agronomique, bien que nécessaires, alourdissent les procédures et rallongent les délais.
Cette incertitude autour de la réglementation agrivoltaïsme pèse lourd sur les investisseurs. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) 2025-2035 en offre un exemple frappant. Non seulement les objectifs photovoltaïques généraux reculent, de 75-100 GW à 65-90 GW d’ici 2035, mais l’agrivoltaïsme disparaît complètement des radars. Aucune trajectoire spécifique ne lui est consacrée.
L’instabilité du secteur se manifeste par des revirements constants. L’épisode du moratoire de juin 2025 illustre cette fragilité : un amendement parlementaire a failli stopper net le développement de l’agrivoltaïsme et des énergies renouvelables.
Les obligations de solarisation des parkings offrent un autre exemple de ces va-et-vient législatifs. Assouplies par l’Assemblée nationale en mai 2025, elles ont été rétablies dès le 3 juillet par la commission mixte paritaire. Résultat : l’obligation de couvrir au moins 35 % de la moitié des parkings de plus de 1500 m² avec des ombrières photovoltaïques redevient la règle.
Les résistances du monde agricole et les défis techniques
La méfiance d’une partie du monde agricole freine également le déploiement de l’agrivoltaïsme. Ces résistances trouvent souvent leur origine dans des préoccupations liées à la préservation des terres et à la souveraineté agricole. Le baromètre de Sun'R révèle cinq préoccupations principales que l'évolution du secteur et les bonnes pratiques mises en place adressent de mieux en mieux.
L'impact paysager : la principale préoccupation
L'impact paysager constitue la principale inquiétude de 50 % des agriculteurs interrogés. Cette préoccupation légitime reflète l'attachement des exploitants à l'identité visuelle de leurs territoires.
Les solutions agrivoltaïques actuelles privilégient toutefois une intégration paysagère soignée, avec des structures adaptées au contexte local et une concertation en amont avec les acteurs du territoire. L'objectif : préserver l'harmonie entre innovation technologique et patrimoine rural.
L'artificialisation des terres : une inquiétude persistante
La crainte de l’artificialisation des terres agricoles reste vive et regroupe 44 % des agriculteurs. Certains agriculteurs redoutent une dégradation de leurs sols ou une perte de souveraineté sur leurs parcelles. Cette méfiance se nourrit parfois d’une confusion entre agrivoltaïsme et photovoltaïque au sol, deux approches pourtant fondamentalement différentes.
Contrairement aux installations photovoltaïques au sol qui peuvent artificialiser durablement les terres, l’agrivoltaïsme préserve la vocation agricole des parcelles. Par exemple, les solutions développées par Sun'Agri n’utilisent pas de béton et permettent un démontage complet des structures. Cette réversibilité garantit que les terres peuvent retrouver leur usage agricole initial sans dégradation permanente du sol.
L'inflation et la spéculation foncière
43 % des agriculteurs redoutent l'impact sur les prix fonciers. Pour répondre à cette inquiétude légitime, les projets agrivoltaïques s'appuient désormais sur des contractualisations longues qui protègent l'exploitant de la spéculation.
L'encadrement réglementaire en cours de finalisation vise également à préserver l'accessibilité des terres agricoles et maintenir un cadre foncier abordable pour les exploitants.
Les faux-projet : un cadre réglementaire renforcé
La crainte des faux projets préoccupe 39 % des agriculteurs, mais le secteur s'organise pour garantir la qualité. Le décret d'avril 2024 impose désormais des critères stricts : obligation de service rendu à l'agriculture, suivi agronomique rigoureux et réversibilité des installations.
Ces exigences éliminent les projets opportunistes et garantissent que chaque installation serve réellement les intérêts agricoles.
Les tensions autour du partage de la valeur
Les questions de partage de valeur préoccupent 35 % des agriculteurs qui redoutent d'être lésés. La proposition de loi Lecamp, actuellement en discussion, tente d’apporter des réponses en instaurant un contrat tripartite entre propriétaire, exploitant et énergéticien.
En outre, les revenus générés permettent aux exploitants de diversifier leurs sources de financement et de sécuriser leur activité face aux aléas climatiques et économiques.
La complexité technique des installations
L'adaptation technique, souvent perçue comme complexe, devient un atout avec l'accompagnement Sun'Agri. L'exploitant partage ses connaissances du terrain tandis que Sun'Agri conçoit et gère les solutions adaptées.
Cette collaboration est cependant facilitée par les technologies intelligentes développées par Sun'Agri. Leurs algorithmes ajustent en temps réel l’ombrage en fonction des besoins des cultures et répondent ainsi efficacement aux contraintes agronomiques.
Des coûts d'installation prohibitifs
Les coûts d'installation restent élevés par rapport au photovoltaïque conventionnel. Le coût d’une installation agrivoltaïque dynamique sur vignes peut par exemple atteindre 1 million d'euros par hectare, soit 1,2 million d'euros par mégawatt-crête (MWc). Ces prix s'expliquent par les structures surélevées, les systèmes de pilotage dynamique et les exigences de suivi agronomique qui augmentent l'investissement initial, même si la rentabilité à long terme reste attractive.
Les coûts d'installation élevés ne pèsent néanmoins pas tant sur l'agriculteur car les investissements sont pris en charge par les porteurs de projets (10 à 20% de fonds propres, le reste par emprunt). Ce modèle garantit aux exploitants les bénéfices technologiques sans exposition financière, tout en leur assurant un revenu complémentaire de 2 000 à 5 000€ par hectare et par an.
Clarifier le cadre légal et impliquer les agriculteurs
La simplification des procédures administratives faciliterait sans nul doute le développement de l’agrivoltaïsme. L’harmonisation des critères d’éligibilité aux différents dispositifs de soutien et la création d’un guichet unique pour les démarches accéléreraient également les projets. À l’instar des défis rencontrés dans le secteur photovoltaïque en 2024, la publication tardive de la PPE a engendré des incertitudes qui freinent les investissements.
Parallèlement, la réussite de l’agrivoltaïsme passe par une approche collaborative impliquant pleinement les agriculteurs dès la conception des projets. Cette démarche participative lève les réticences et optimise les bénéfices pour toutes les parties prenantes.
La formation reste cruciale. Des programmes de sensibilisation, s’appuyant sur les résultats probants des installations existantes, changeraient la donne. Rien ne vaut les preuves concrètes sur le terrain pour convaincre.
L’accompagnement personnalisé peut également peser favorablement dans la balance. L’approche développée par Sun'Agri, basée sur un suivi agronomique rigoureux et des indicateurs mesurables, rassure les exploitants sur les bénéfices concrets pour leurs cultures.
C’est dans cet esprit également que le Sun’Agri Club a vu le jour. Cette communauté d’agriculteurs est une excellente manière de s’informer sur l’agrivoltaïsme en partageant les bonnes pratiques et les retours d’expériences concrètes d’exploitants.
Encourager l'innovation et sensibiliser les acteurs
L’accélération de la recherche et développement lèverait les freins à l’agrivoltaïsme d’ordre technique. Les programmes de recherche conjoints entre instituts techniques et entreprises comme Sun'Agri doivent être renforcés pour optimiser les technologies et réduire les coûts.
PalFruitsD'Occ : l'intelligence artificielle au service de l'arboriculture
Le projet collaboratif PalFruitD'Occ, lancé en avril 2024, financé par France 2030 et soutenu par la région Occitanie en est un exemple concret. Cette initiative met en œuvre des filets pilotés par intelligence artificielle sur les sites de Castelsarrasin et Rodilhan, en partenariat avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin et d’autres acteurs agricoles locaux.
Life : mesurer l'impact environnemental de l'agrivoltaïsme
Autre exemple parlant, le projet Life qui débutera le 1er septembre 2025 et se concentre sur l’impact de l’agrivoltaïsme dynamique sur l’eau, le sol et la biodiversité. Sur les sites de La Valette et La Pugère et accompagnés de partenaires comme INRAE et Célesta-Lab, ce projet innovant vise à mesurer les effets de l’agrivoltaïsme dynamique sur les processus biologiques.
Nouveaux modèles de financement et sensibilisation
Question financement, l'innovation peut débloquer des situations. Financement participatif, mécanismes de tiers-investissement… Ces nouvelles approches ouvrent l'agrivoltaïsme à toutes les exploitations, même les plus modestes.
Du côté du grand public, le travail de pédagogie à accomplir reste conséquent. Le baromètre de Sun'Agri révèle toutefois un paradoxe intéressant : alors que seulement 20 % des Français se sentent bien informés sur l'agrivoltaïsme, 61 % d'entre eux seraient favorables à une installation agrivoltaïque dans leur proche environnement.
Cette ouverture d'esprit contraste avec le manque d'information et souligne l'importance des campagnes de sensibilisation.
Mobiliser les acteurs locaux
L'implication des collectivités territoriales est également essentielle. Les acteurs locaux, par leur connaissance du terrain et leur capacité de médiation, facilitent l'acceptabilité sociale des projets et accompagnent leur intégration harmonieuse dans les territoires.
L'organisation de visites de sites et de journées techniques est d’ailleurs un excellent moyen de concrétiser les discours par des preuves tangibles. Sun'Agri illustre cette approche en organisant des visites de terrain qui permettent aux élus et aux professionnels agricoles de constater directement les bénéfices de l'agrivoltaïsme en conditions réelles.
Lever les freins à l'agrivoltaïsme : un travail collectif tourné vers l'avenir
L’avenir de l’agrivoltaïsme en France se joue maintenant. Plus qu’une simple innovation technologique, c’est une réponse concrète aux enjeux agricoles de demain. Cependant, son développement ne pourra réussir sans un effort concerté de tous les acteurs.
Le cadre réglementaire doit se stabiliser, les agriculteurs doivent y trouver leur compte, la technologie doit encore mûrir. Dans un contexte où agriculture et énergie sont au cœur des préoccupations, l’agrivoltaïsme propose une solution pragmatique. À nous de lever les freins à l’agrivoltaïsme pour une agriculture française plus résiliente et tournée vers l’avenir.
Pour récapituler :
|
Acteurs |
Freins identifiés |
Solutions proposées |
|
Législateur / État |
- Cadre réglementaire instable et complexe (loi APER, décret du 8 avril 2024)- Moratoire de juin 2025- Manque de vision dans la PPE 2025-2035 |
- Stabiliser le cadre juridique- Clarifier les règles (guichet unique, critères harmonisés)- Inclure l’agrivoltaïsme dans la stratégie nationale (PPE) |
|
Investisseurs |
- Incertitudes réglementaires- Retours législatifs imprévisibles |
- Sécurité juridique accrue- Meilleure visibilité sur la rentabilité à long terme |
|
Agriculteurs |
- Méfiance vis-à-vis de l’artificialisation des terres- Crainte de perte de souveraineté- Complexité des projets- Tensions sur le partage de la valeur |
- Participation dès la conception- Formation et sensibilisation- Suivi agronomique rigoureux (ex : Sun’Agri)- Cadre tripartite pour la répartition de la valeur |
|
Filière technique / Industriels |
- Adaptation spécifique à chaque exploitation- Manque de standardisation- Coûts d’installation élevés |
- R&D renforcée (ex : projets PalFruitD'Occ, Life)- Technologies intelligentes de pilotage (Sun’Agri)- Financement participatif et tiers-investissement |
|
Collectivités territoriales |
- Acceptabilité sociale parfois faible |
- Implication dans les projets- Médiation locale- Organisation de visites de site et de journées techniques |
|
Grand public / Opinion |
- Faible niveau d'information (20 % se sentent bien informés selon Sun’Agri) |
- Campagnes de sensibilisation ciblées |
|
Instituts de recherche |
- Besoin d’évaluation des impacts réels (eau, sol, biodiversité) |
- Programmes collaboratifs avec acteurs de terrain (INRAE, Célesta-Lab, etc.) |
Marie dupont
Vice-président chargé du développement économique à la communauté d'agglomération de Cambrai


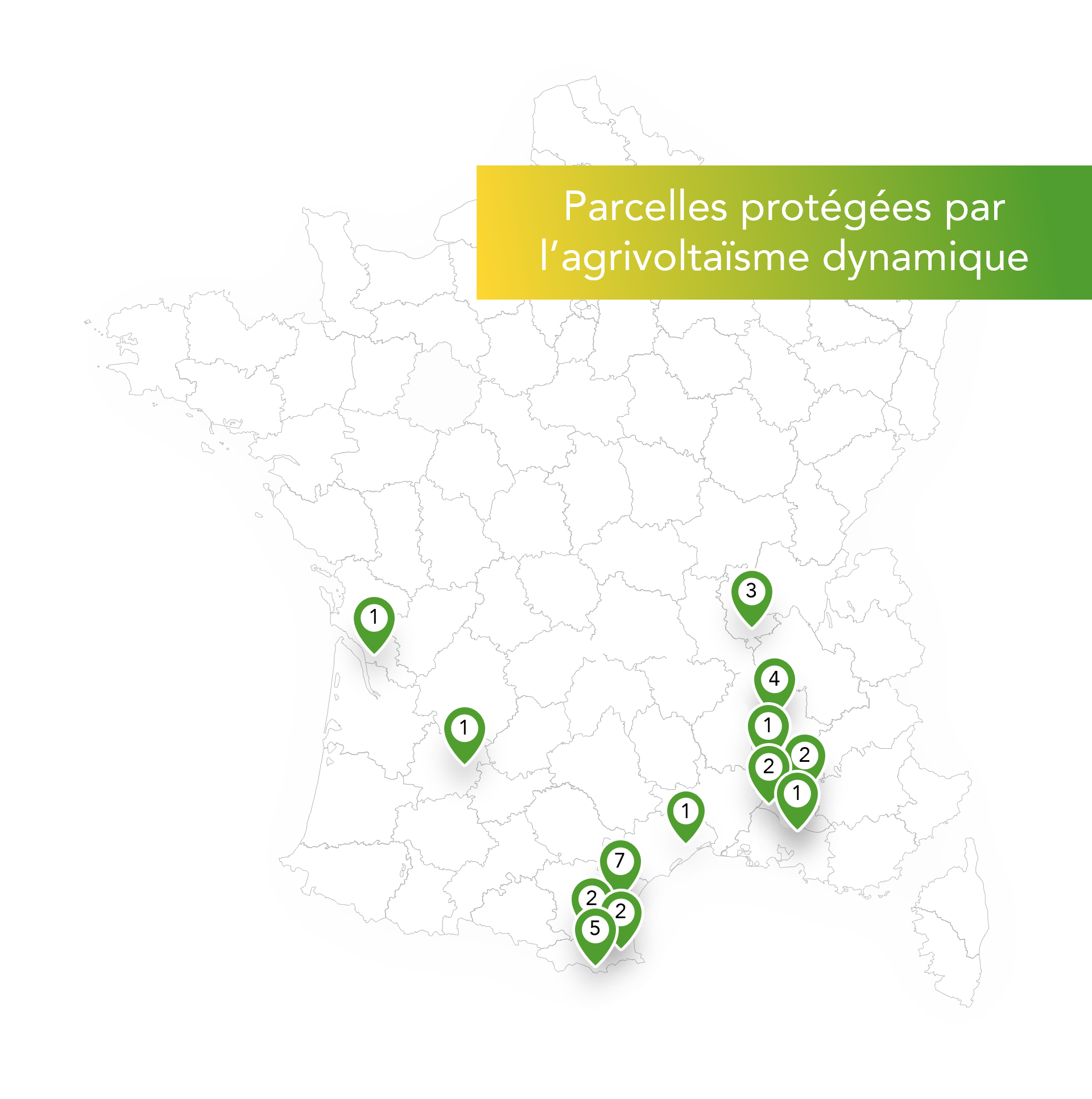
.jpg)


